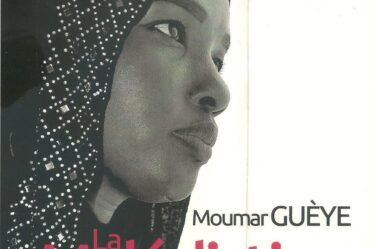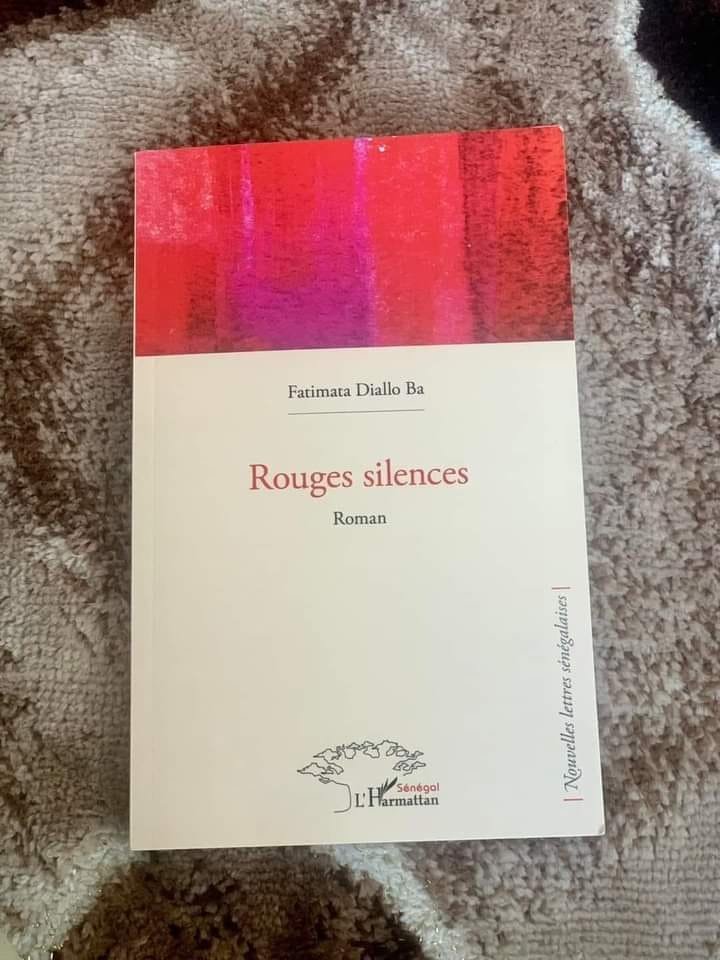
« Des cris sous la peau » de Fatima Diallo BÂ
« Une petite fille de quarante-cinq ans prend l’avion pour la deuxième fois de sa vie, en ce caniculaire juillet parisien. » Voici l’incipit d’un roman passionnant et riche – qui se lit et se savoure, mot après mot, page après page, chapitre après chapitre- dans la langue, le schéma narratif, les personnages, le cadre spatio-temporel, les dialogues et le récit, la contextualisation de l’œuvre dans son temps, les sous-thèmes nichés entre les interlignes. S’il est vrai que les gens ne s’expriment pas de la même façon suivant leur éducation, il est aussi véridique que la parlure d’un narrateur varie en fonction du message que l’auteur veut faire passer à son lectorat. Celui de Fatima Diallo BÂ est clair et sans équivoque : il est à découvrir, progressivement, au fil du livre.
Dans cette œuvre, l’héroïne, la petite fille de quarante-cinq ans, est timorée, craintive, hésitante, intérieurement déchirée, déchiquetée, dans un implacable silence. Elle ne parle presque pas, sobre dans ses goûts, sombre dans ses rêves, frêle, fragile, déprimée, dépressive. Elle subit la vie qu’elle regarde, impuissante, dicter quotidiennement le cours des choses, de ses choix. Employée modèle dans un hôpital, à part les soins qu’elle prodigue à ses patients et la lecture de textes, il n’y a pas quelque chose d’autre qui puisse la distraire ou habiter momentanément ses passions, sinon qu’une réticence mystérieuse, une indifférence totale, un dégoût de l’existence. Tout laisse à croire, à première vue, qu’elle est capricieuse, mais le mal est là, en réalité, plus profond, la vérité, plus sérieuse. Visiblement mortifiée, elle se maquille de révérence et de bienséance à travers de petites phrases laconiques, de petits sourires douloureux, une pépite d’espérance ternie par le poids de ses inhibitions, et on ignore toujours la cause de cette introversion, comme pour confirmer un penseur qui disait : il est des fois dans la vie des êtres où tout devient naturellement inexplicable.
Au début, on ne sait même pas comment elle s’appelle. Elle est un véritable quidam. Un joli paradoxe lexical, ou mieux, une formidable ironie stylistique, « Une petite fille de quarante-cinq ans ». Tout ce qu’on sait sur elle, c’est qu’elle travaille dans la santé, qu’elle a un mari distant, violent et qu’elle porte un balluchon de refoulements qu’elle supporte stoïquement et prête à prendre l’avion de Paris vers Dakar pour prendre part au ganale1 de sa tante maternelle et au yebbi2. A travers ce ganale, le lecteur assiste à toute une histoire, à la fois déroutante et captivante. Il découvre, au fil des pages, la psychologie des personnages, les disparités entre la vie au centre-ville de Dakar et celle périphérique, des manquements criards dans la gestion publique, des problèmes liés au comportement des gens, à leur éducation, la misère sociale, la prise en charge médicale difficile ou coûteuse, et surtout certaines valeurs de la société sénégalaise, en particulier, et africaine, en général, dont la sutura3 et le muñ4, le masla5, qui, dans le cas échéant, peuvent concourir à protéger des délinquants.
Entre le noir et le blanc, la lumière et l’obscurité, le ciel et la terre, termes qui reviennent fréquemment, toute une technique d’écriture aux bornes du fictif et du vraisemblable prend sens sous la plume de Fatima Diallo BÂ, avec des préoccupations et soucis des gens, d’une part, inhérents à l’existence, et des solutions des sociétés humaines, la patience et la foi en Dieu, émanations de l’angoisse existentielle, d’autre part. C’est dire que le problème dans cette intrigue est adroitement tricoté en mailles tels des chapitres titrés, mutation ou transversalité de genres littéraires, avec la délicate fibre sociologique des belles lettres sénégalaises, legs de l’auteure. Le dialogue fond succulemment dans le récit. Les phrases verbales glissent jusqu’aux nominales. Elles sont simples, composées et complexes, différentes postures, sans ratures, dans la merveilleuse filature de l’ouvrage, architecture d’une romancière talentueuse. La prose bise le ver. Le discours passe de l’indirect au direct, du direct à l’indirect libre. Le narrateur interroge et s’interroge. Et au livre, solide embarcation attrayante, de tanguer, dans sa forme souple et légère, entre la rivière poétique de la longue nouvelle et le fleuve émouvant du roman de mœurs. Et l’art se décloisonne, dans les genres et les formes. Tout naît d’une jalousie entre deux sœurs : la cadette Gnilane, mère de la petite fille, plus séduisante que l’aînée, Ndiémé, tante de la petite fille. Gnilane s’était éprise de Diogoye, un salum-salum pur-sang, brave cultivateur qui, un jour, sauva sa dulcinée de l’attaque inattendue d’un boa. Ce fut le déclic du coup de foudre entre les deux, profondément amoureux et enclins à une série de lutineries et de batifolages occasionnels, dans les champs, à l’insu de tous, excepté la sœur aînée. Ndiémé, ne pouvant plus supporter sa solitude qui perdurait, tenta par tous les moyens de ravir ingratement l’amant de Gnilane, Diogoye, en vain. Elle finit tout simplement par rompre le pacte de la discrétion et de dénoncer les escapades de sa cadette dans les plantations. Fervents traditionalistes, les parents les envoyèrent à Dakar afin d’éloigner Gnilane et Diogoye, mais celle-ci portait déjà, dans son ventre, l’enfant de son bien-aimé. Employée domestique à Dakar, vivant dans la pauvreté et la promiscuité, Gnilane essayait tant bien que mal de concilier son travail et les exigences de la parturition, tandis-que sa grande sœur, usant de subterfuges, vivait de la manne des hommes sur ses largesses au lit. Hélas, Gnilane n’a pu résister longtemps à la bataille pour la vie, elle donna naissance à une fille, et trépassa peu de temps après, celle qui est surnommée « la petite fille », qu’elle confia à Ndiémé, déjà unie à un courtier, aux attitudes et comportements aigres et amers. Ndiémé eut, elle aussi, une fille, Arame, avec son mari courtier lequel avait réussi à avoir une spacieuse villa dans une banlieue de Dakar, Keur Massar. La petite fille et sa cousine, Arame, grandirent ensemble dans un climat de convoitises et de frustrations notoires, au préjudice de la première, plus raffinée et plus douée dans les études. Elles furent, l’une comme l’autre, dans leur enfance, victimes d’abus sexuels répétitifs du mari de Ndiémé qui se permettait tous les délits à cause d’une prétendue situation de confort dont il jouissait, après de longues années de spéculations foncières et de spoliations financières. Plus tard, la petite fille, brillante élève, émigra en France où elle trouva un emploi dans un hôpital parisien. Elle se calfeutra dans un monde décoré par un magnifique triptyque : le travail, la lecture et ses silencieuses souffrances morales. Durant le retour du pèlerinage à la Mecque de la tante Ndiémé à Dakar, la fastueuse cérémonie culturelle et non cultuelle du ganale était enfin l’occasion idéale pour la tante Ndiémé, la pèlerine qui ne reçut point le titre de « hadja », d’étaler sa richesse dans un quartier pauvre, et pour la petite fille de vomir, devant son oncle vicieux, vil pédophile, les laves du volcan qui brûlaient ses entrailles, dilataient ses nerfs depuis une éternité de mutisme, et qui lui empêchaient de devenir adulte, qui la jugulaient, la sanglaient, la ligotaient dans la parfaite réserve, dans l’indifférence totale, devant l’ignorance absolue de la société. Cette velléité de rébellion, touche de bellicosité, insufflée par sa défunte mère, Gnilane, au cours d’un rêve, lui fit accepter sa personne et redécouvrir sa personnalité. Et son prénom évasif, lie de jouvence, flotte comme une souvenance épave, jusqu’à la surface du papier argenté, aux rayures graves, aux traits fins, aux ponctuations clignotant des reflets dorés : Yandé. C’est dire autrement qu’ici l’écriture se réinvente et les belles histoires se réincarnent inexorablement dans un tableau binaire merveilleusement dessiné par une osmose narrative.
D’un point de vue psychologique, la petite fille est l’image projetée de sa cousine, Arame, dans le rapport symétrique du miroir double du récit. Toutes les deux, victimes de l’inceste de l’oncle, pour la première, et du père biologique ou adoptif, pour la deuxième. Horreur ne peut être plus monstrueuse que d’abuser de sa nièce et surtout de sa propre fille qu’on refuse de reconnaitre ; l’épouse, pour ne pas dire la partenaire, était capable et coupable, à l’instar de son mari, de tous les forfaits. La petite fille s’installa dans la sobriété et la crainte de sa féminité, de son humanité, sa cousine, Arame, dans la boulimie et le faux pardon cauchemardesque.
Entre les deux blessures, le double délit d’un couple de malfaiteurs accomplis, et les nombreux feed-back dans le récit, se dessinent et se colorent, le noir et le blanc, le haut et le bas, le ciel et la terre, la bible et le coran, la prière et la rédemption, l’absolution et l’oubli, le dédoublement de la personnalité de l’héroïne, la narration de la première personne, expression de finitude du regard, dans la narration à la troisième personne, toutes au singulier, seing d’un pouvoir illimité du narrateur. C’est comme qui dirait une sorte de mise en abyme, non plus à travers ce qui est dit – une histoire dans une histoire -, mais par l’astucieuse façon de le dire – une écriture dans une écriture-. Et « Des cris » d’amertume jaillirent, telle une éruption volcanique, « sous la peau », écume et spume âpres et âcres de la petite fille, au crépuscule du ganale, devant son oncle et tuteur, cynique, des filles, Yandé, retournée après cette délivrance dans sa vie parisienne, et Arame, demeurée dans son monotone existence dakaroise. Elles devinrent des dames, aux meurtrissures livides, après l’explosion de leurs maux, terribles épreuves, déchargées du fardeau d’intimidations et de menaces d’un prédateur sexuel démasqué, dénudé et décharné devant sa femme, vice, complice et supplice. Il faut aussi noter les bienfaits de l’instruction, particulièrement des filles, dans la société. La petite fille, plus instruite, a su dénoncer, même tardivement, à la vindicte, son oncle incestueux que protégeait sa tante Ndiémé, alors que sa cousine, Arame, à la scolarité brève, n’a pu se libérer seule, éternellement blottie dans des interdits sociaux : « Ne point dévaloriser un parent quels que soient ses défauts ». Malgré cela, la petite fille a brisé net ce tabou par une vengeance apparemment préméditée, depuis Paris, durant le ganale. Ce roman est fécond dans le fond et dans la forme, le style classique, attendrissant, truculent, unique, rappelle, à certains égards, la crème de la littérature sénégalaise, africaine, humaine. Son message est fort ; il toise, en particulier, l’inhumaine condition féminine, le laxisme de la communauté envers les enfants orphelins, dans un monde où le phallus, puissant dans son rang et dans son règne, terrorise impunément, bien des fois, à plus forte raison avec la moindre opulence financière, la moindre aisance matérielle, et le regard négligent et insouciant de la société sur des personnes impunies à cause même de certaines pesanteurs sociales que confortent des valeurs, comme le kersa6, le muñ, la sutura et le masla en faveur des satyres et au détriment des victimes : les femmes et les enfants.
Salif Niokhor Diop, poète, romancier