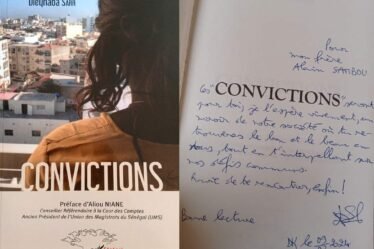Par Mouhamed Sow B.
Quitter la poésie ou manquer de la quitter, il s’établit en tout cas dans ce recueil de Thioye une véritable poétique de l’absence. Une absence manifeste à différentes échelles où, de près, le discours poétique côtoie la description pour imager cette amplitude du vide: des yeux hagards des familiers aux regards vides des animaux, en passant par un silence continu dès que surgit le souvenir, la poésie se formule comme prise en charge du silence comme du vide, respectivement contrepoids de parole et de présence. L’absence en soi, non de ceci ou de cela comme disait Derrida, mais une absence totale, s’avère être en réalité une présence abstraite, immatérielle puisque la mort implique le silence et puisque c’est la vie qui donne son sens au verbe (vice versa): «Les morts épousent verbe de Dieu / où tout silence est message de vérité / que seul voit l’œil d’un cœur éveillé par l’Amour» dit le poète. Mais, ce qui certainement retient Elaz dans l’usage singulier du Verbe, c’est qu’il permet outre le dialogisme outre-tombe d’exprimer une souche identitaire qui fait la particularité de son humanisme: sens de l’honneur et de dignité comme principe de Vie.
Faisant jongler la sagesse sénégalaise à l’étendue du souffle poétique, il élabore ainsi un métissage linguistique et surtout épistémique qui fonde cette poétique de la dialectique. Cette tendance lui offre un tremplin de légitimation d’un lexique de jadis repris en affirmation identitaire et joint les «yeux» comme reflet lumineux des âmes des ancêtres: « je porte la mémoire vivante de mon défunt père/ qui avait dans ses yeux-lumière les souvenirs des ancêtres». S’affirme alors un panthéisme remarquable, toute la nature et toutes ses composantes formulent la présence des grandes réalités, des réalités certainement audibles par l’autre oreille et visibles par le troisième, mais qui ne se formule que sous la bannière du Verbe, sous le sceau du poème.
Ce qui certainement le retient, dans cette première tentative heureuse-ment manquée, c’est la capacité à dire l’absence et à en fonder une nouvelle présence. Nous parlions de Derrida: « Seule l’absence pure- non pas l’absence de ceci ou de cela- mais l’absence de tout où s’annonce toute présence- peut inspirer, autrement dit travailler. Le livre pur est naturellement tourné vers l’orient de cette absence, qui est, par-delà ou en deçà de la génialité de toute richesse, son contenu propre et premier» dit-il. Ainsi, le vide de la présence offre une première injonction à l’écriture puisqu’elle comble le néant et remplit le silence ne serait-ce que par la sémantique infinie de la mémoire qui est une actualisation de l’absence, et qui trouve sa matérialisation dans la codification du poème.
Dans la deuxième partition, le poète se mue en observateur de Prométhée et se figure à équidistance entre l’humanité et l’Olympe. Ce rapport parallèle est intimement lié à la tradition de la poésie puisque le feu des dieux peut se constituer en délire poétique dans sa totalité enivrante, ou comme sagesse dans sa structuration à taille humaine. Socrate disait-il à Phèdre que « les plus grands biens nous arrivent par un délire inspiré des dieux». Mais, fort du poids de l’intertextualité, le poète court-circuite le récit mythe qu’il superpose au récit invariant chrétien puisque le feu sans lumière divine raccourcit le chemin vers l’obscurantisme. Revoyons par exemple l’avertissement célèbre de Gargantua à son fils.
L’invitation du serpent à la quiétude originelle est donc l’allégorie de la boîte de Pandore. Cette deuxième partition est ainsi une figuration du désordre qui a jadis fragmenté l’histoire de l’humanité, édénique dans la quiétude et éternelle tentative de sa restauration après la transgression. Pour ce faire, Elaz Ndongo Thioye organise un système verbal où la faiblesse majeure de l’homme serait éclairée par le brin lumineux de folie, céleste et sacré. Le poète met donc en place un espace poétique qui permet de transgresser la norme et léviter vers la source perdue, certainement depuis Babel, du langage ontologique. Il confirme ainsi Michel Foucault qui disait: « la folie assure des communications impossibles, franchit des limites qui, d’ordinaire, sont infranchissables. La folie, c’est la rencontre impossible, et c’est le lieu de l’impossible ».
La folie joue alors le rôle de langage analogique et de contrepoids du langage. Mais cette voix/voie de poésie se superpose intégralement aux souffles des ancêtres, fleurs et sève de vie. Elle s’est appuyée sur les racines de cette identité avant de s’ouvrir à l’Olympe, le souffle des Jinns du Baobab avant le feu sacré de Prométhée. Vient alors une série de quatrains en rimes croisées, où après avoir connu les Jinns et l’Olympe, le poète décline sa cité de l’idéal basée sur la pureté ontologique symbolisée par le souffle du poète, souffle de prière, sanctification.
Ce qui donc, dans cette deuxième partition, empêche le poète de briser sa plume, c’est l’étonnante force de l’espoir que suscitent les pouvoirs du Verbe à bâtir un idéal humaniste qui résistera à l’obscurantisme, puisque les ténèbres de jadis furent dissoutes par la Lumière du Verbe dit au 3e verset. Et puisque ce même Verbe s’est fait chair et Amour, la parole du poète qui régénère et symbolise l’amour, dans un Temps en proie au doute, est abreuvoir pour « tous les cœurs en désir de beauté ».
C’est après cet établissement de l’idéal que commencera à résonner les échos de « l’appel [éternel] du poème » auquel le poète cédera dans la troisième partition. Trouvant le salut dans le silence, le poète y extirpe le sens de la vie qu’il fait revêtir au verbe puisque le sens, lui-même, doit attendre d’être dit pour porter la sémantique de la vie.
Autour d’une organisation trouble de la vie, l’humanité se perd dans les labyrinthes engendrés depuis Pandore, le verbe redevient souverain élément de régénérescence, de résurrection de l’homme dans son statut de reflet du divin, car « seul le vers est printemps ». Mais la troisième partition est en réalité une théorie par l’exemple, une lettre de cachet. S’il faille réellement refaire le monde par le Verbe, s’il faille re-structurer le monde par le poème, il faut nécessairement dire ce qu’est et comment doit être le poème.
Dans cette dernière séquence, Elaz montre tout un décalage entre le poète, le véritable, celui-là qui jadis sentit directement « du Ciel l’influence secrète » (Boileau) et celui qui, par convention, obéit à la versification classique tordant la valeur du souffle premier et agressant l’Emotion. Le poème, comme le Verbe initial, celui du Commencement, est fondement et souffle de Vie sur la vie, il est « Un grain de souffle semé par les mains d’Apollon dans le ventre du poète ». Suprême sagesse et Délire sacré, la poésie s’organise et s’enveloppe sur la totalité du langage, à mi-chemin entre le Silence et le Verbe.
Alors, que le poète continue de dire toujours le poème, sinon que serait le monde ?