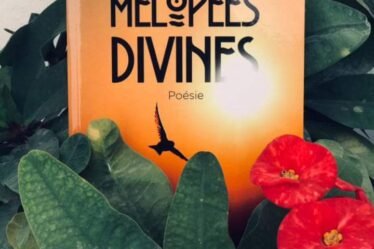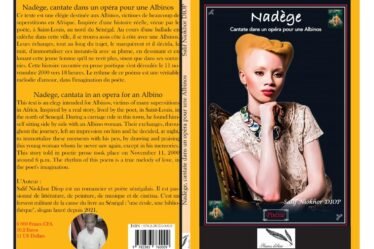L’amateur de littérature qui s’intéresse à la poésie sénégalaise sera frappé par la portion congrue qu’y occupent les œuvres de femmes. Mais il peut ne pas être tout à fait surpris s’il sait qu’il en est ainsi dans les littératures plus anciennes comme celle de la France. Il sera d’autant moins étonné s’il a déjà, comme nous, en de multiples occasions, vainement cherché, comme par exemple dans l’article « Les 80 femmes qui dominent les Lettres » par lequel Le Figaro rendait compte, le 19 mai 1989, lors du Salon du livre à Paris, de l’offensive des femmes en littérature, la simple évocation ou citation d’une poétesse.
Mais si sa déception ne s’est pas arrêtée là et qu’à la lecture des Sénégalaises il a constaté la permanence de thèmes qui semblent condamner les femmes au narcissisme et, partant, au conformisme thématique, leur poésie ayant pour objet la femme et suivant en cela la tradition, il n’en remarque pas moins qu’il n’y a là conformisme que devant la vie réelle. Face à la littérature, il voit à travers ces œuvres, et peut-être du fait de ce conformisme social, un réel écart et une forme nouvelle d’écriture.
En vérité, même sur le plan thématique, il y a derrière l’apparente reprise de l’archétype de la femme objet d’amour ou ayant son cœur en bandoulière un réel déplacement. D’ordinaire, la poésie disait la beauté de la femme et les effets de celle-ci sur le sujet écrivant, c’est-à-dire, en bref, comment la femme est perçue, en tant qu’objet extérieur, par une intériorité sur laquelle elle agit. Quand elles écrivent, les femmes ne sont plus de simples héroïnes, des inspiratrices ou des égéries amoureuses. La femme n’est plus dans leurs textes celle qui rend le poète malade d’amour et malheureux de ce fait ; elle n’est plus celle dont la force d’attraction soumet les hommes et les transforme en serviteurs comme dans la poésie française du XVIe siècle. Elle est, du moins dans les œuvres de femmes ici considérées et contrairement à l’image qu’en donnent jusque-là les poètes soumis, conformément à la vision sociale, faiblesse physique, morale et sentimentale mais aussi générosité et spontanéité :
Serait-ce démodé d’avoir un cœur ?
Kiné Kirama Fall, « Qui le sait », in Chants de la rivière fraîche, Dakar, N.É.A., 1975, p. 30.
Serait-il ridicule de le laisser battre et de désirer sa chaleur ?
Doit-on toujours le surveiller
Pour qu’il ne s’éteigne pas dans la douleur?
Les femmes ajoutent souvent à ce portrait un aspect qui relève plus du désir et de la quête que de la réalité :
Mon cœur est ardent, comme brûlant, mon soleil.
Grand aussi mon cœur, comme l’Afrique mon grand cœur.
Habitée d’un grand cœur, mais ne pouvoir aimer…
Ndèye Coumba Mbengue Diakhate, « Libération », in Filles du soleil, Dakar, N.É.A., 1980, p. 28
Aimer toute la terre, aimer tous ses fils.
Être femme, mais ne pouvoir créer ;
Créer, non seulement procréer.
Cette excessive subjectivité et ce sentimentalisme qui font qu’elles ne sortent jamais d’elles-mêmes — Senghor dit de Kiné Kirama Fall qu’elle nous parle surtout d’elle — font de ces poétesses des écrivains non engagés ou partiellement engagés pour l’unique cause féministe, parfois de façon seulement implicite même si ce non-engagement ne relève pas, comme chez Breton, d’un choix esthétique.
Les poétesses remplacent ainsi l’image littéraire de la femme par une image sociale qu’elles tentent de littéraliser. Ce conformisme dans la conception de ce qu’est la femme cache en fait une idéologie féministe conservatrice, idéologie qui repose sur une vision sociale traditionnelle, la poésie des femmes suggérant un portrait moral singulier et positif qui s’oppose à l’hostilité du monde et à son indifférence devant le mal.
Ainsi, si la description de la vie et même des sentiments des sujets poétiques féminins porte en vérité une dénonciation de l’asservissement des femmes et si cette dénonciation, implicite dans l’attendrissement des poétesses, relève du féminisme militant, il faut cependant remarquer que l’ambition des auteurs, leurs aspirations sont calquées sur ce que la société pose comme étant la féminité. De ce point de vue, le regard sur les enfants, ici thème majeur, fait souvent allusion à la pitié, au sentiment maternel et à la maternité, distinguant ainsi la poésie des femmes non pas parce que les autres poésies ignorent ces sentiments mais parce que ces sentiments, de par le statut discursif qu’ils occupent, trahissent et révèlent leurs auteurs. Là les poétesses rejoignent les romancières dans l’apitoiement devant la misère et en particulier devant celle des enfants :
Si j’avais le pouvoir du sorcier magicien,
Je ferai mes amis…
Ô ! mais que de choses merveilleuses.
Je ferai tout d’abord,
Qu’on ne voie plus jamais,
Sous aucun toit du monde,
Des enfants affamés, tout perclus faute de pain.
Qu’on ne voie plus jamais,
Ndèye Coumba Mbengue Diakhate, « Supplique pour les petits (voix de mère) », in op. cit., p. 22.
À ces rues sombres le soir,
Des enfants en guenilles, grelottant sous le froid4.
Ce n’est là qu’une forme de l’immense amour que les femmes étalent dans leurs œuvres, amour qui va de la sensualité érotique au mysticisme religieux. Kiné Kirama Fall dans tous ses recueils, Fatou Ndiaye Sow dans certains poèmes consacrés à la beauté de la Nature, Ndèye Coumba Mbengue Diakhate prise de nostalgie pour le pays natal dans une Allemagne pluvieuse évoquent, toutes, la figure de l’Éternel et disent leur amour pour Dieu.
L’encre poétique des Sénégalaises, comme celle de tous les sujets poétiques, exprimant des sentiments nés de l’expérience des auteurs, s’attache, de ce fait, vu l’occupation sociale des femmes dans une société qui les discrimine, à la plus banale quotidienneté, à côté des plus exaltants et nobles sentiments comme l’amour. Fatou Ndiaye Sow, dans Fleurs du Sahel, colle des morceaux de chansons populaires dans ses poèmes évoquant des cérémonies sociales traditionnelles5 et va même jusqu’à décrire les pratiques fétichistes des bonnes femmes :
Jeudi, jour des offrandes
Id., « Offrandes », Ibid., p. 37.
Trois colas blanches
Trois cauris
Et la calebasse de Lait
Jeudi, sacrifice du jour
Id., « Sacrifice », Ibid., p. 39.
Un poulet rouge, un poulet blanc,
Effluves de sang
Narguant le rire séculaire
D’une destinée invalide
Il pleut triste. Le temps gris. Le ciel mort.
Ndèye Coumba Mbengue Diakhate, « Lointain pays », in op. cit., p. 26.
Quelque rumeur métallique annonce au loin un train
La rumeur s’est tue …
Sous la maîtrise du vent, les arbres du jardin ploient.
Mais derrière l’Aar, le rideau de sapins ne semble guère s’émouvoir.
Il y a, dans cette pratique, un refus délibéré de la poéticité des sujets désincarnés et une revendication de celle du quotidien actualisé. Par cela, les poétesses sénégalaises se rapprochent des précurseurs modernistes de l’Esprit nouveau comme Apollinaire et, consciemment ou inconsciemment, exploitent comme eux, souvent, les mêmes ressources poétisantes de la dissonance entre la banalité du contenu et la solennité de son expression comme dans les exemples ci-dessus. Parfois, le rapport est inversé et la grandeur des sentiments abstraits et profonds se métaphorise dans un discours concret où la poéticité métaphorique ne domine nullement le caractère référentiel de la signifiance immédiate et littérale. Cela est illustré parfaitement dans le passage ci-dessous où Ndèye Coumba Mbengue Diakhate veut suggérer, dans la description de l’atmosphère, la nostalgie du lointain pays natal :
L’encre des femmes, traduisant le sentiment des femmes, inscrit donc celui-ci dans l’idéologie collective et la pensée commune et, partant de là, la forme du discours poétique reste dans le conformisme social et transcrit le discours quotidien. Il n’y en a pas moins subversion de la tradition littéraire. Parce que l’image que la littérature poétique donne en général des femmes et la façon dont elle en parle diffèrent fondamentalement du réel. Or les poétesses du Sénégal semblent ne jamais sortir de leur quotidien, nous l’avons déjà souligné à propos des thèmes.
Sur le plan de la forme de l’expression, il en est de même. C’est pourquoi, malgré la surprise par exemple que manifeste le préfacier du premier recueil de Kiné Kirama Fall, le poète Léopold Sédar Senghor, devant la spontanéité de l’auteur parlant de son amour et cela malgré la « kersa » (pudeur) sénégalaise, et malgré le caractère mystique du second recueil, la poétique demeure celle de l’écart mais d’un écart devant le dire littéraire. Nous n’en voulons pour preuve que la présence dans ce recueil d’un langage également érotique à côté ou dans le discours religieux, ce qui consolide la dissonance. Mais celle-ci, depuis les surréalistes, a cessé d’être une faute pour apparaître comme une valeur poétique. D’ailleurs, sans que le langage quotidien sénégalais et le parler de la poésie soient équivalents, la spontanéité sentimentale et le discours impudique subséquent constituent des écarts par rapport à l’un et à l’autre, surtout au regard de la forme du contenu. Parce que le lexique et la syntaxe, en ce qu’ils portent les traces de la traduction, restent liés au quotidien :
Je suis amoureuse
Tout en moi le dit
Mes yeux qui se mouillent de larmes
Dès que je dis son nom
Mes pas qui cherchent ses pas…………………….
Kiné Kirama Fall, « Sa Ma Kole », in Les élans de grâce, Yaoundé, CLÉ, 1979, p. 18.
Les préfaciers de Kiné Kirama Fall, Senghor comme le père Mveng, justifient ce fait par le faible niveau d’instruction de la poétesse mais, sans sous-entendre que toutes les poétesses du Sénégal sont, comme elle, de faible niveau intellectuel, nous remarquerons que leurs textes se ressemblent quant à la forme. Ils décalquent, le plus souvent sans artifice, l’intériorité des sujets et la simplicité de leurs sentiments par des phrases et des mots de tous les jours. Sans doute, le français constitue ici un refuge qui permet un dire cru dénudé des euphémismes de la pudeur africaine. À ce titre, l’écriture en cette langue d’emprunt peut présenter, sans cesser d’être étroite pour la traduction de certaines réalités autochtones, quelque avantage dans le domaine de l’expressivité. Néanmoins, le caractère quotidien du discours poétique est tel que les textes frisent parfois l’alternance codique. En témoignent non seulement les titres, « Sa Ma Kole » de Kiné K. Fall, « Baw Naan » de Fatou Ndiaye Sow, « Jigeen Reck Nga » de Ndèye Coumba Mbengue Diakhate mais aussi les textes eux-mêmes :
Jigeen reck nga !
Ndèye Coumba Mbengue Diakhate, « Jigeen reck nga », in op. cit., p. 18.
Reck !… Ô douleur de mon sein, douleur sanglante !
Ndeyssan ! Reck !…
Les expressions ici empruntées au wolof sont, comme les phrases toutes faites, les enseignes et slogans collés dans les poèmes d’Apollinaire, des dadaïstes ou des surréalistes, tirées de la vie courante. C’est là un double baroquisme vis-à-vis du langage poétique traditionnel français, d’abord par le mélange de registres avec ce goût nouveau qu’Aragon appelait en 1930 « goût de la réclame » et ensuite par le changement de code qui est une autre forme de reprise des idiotismes. Mais Aragon disait dans ce même article de 1930 : « Le sens commun d’un idiotisme se perd devant l’emploi poétique qui en est fait au profit d’un sens fort et nouveau, à l’instant découvert. »
Louis Aragon, « Introduction à 1930 », La Révolution surréaliste, no 12, 15 décembre 1929, p. 60.
Mais ce sens fort et nouveau que des poètes comme Senghor ont souvent pu mettre dans leurs textes est, pour la plupart des jeunes poètes, tout juste un mirage. Nos poétesses n’échappent pas tout à fait à ce mirage et il est regrettable que dans leurs écrits l’exploitation des ressources des idiotismes ne s’accompagne d’une culture du rythme comme chez Senghor ou d’un code métaphorique qui dépasse la littéralité des textes. Mais peut-être obéit-on ici à un autre principe moderne, cette fois-ci énoncé par Lautréamont et selon lequel la poésie doit être faite par tout le monde et non par un seul ; ce qui justifierait la reprise complète du discours de certains textes populaires et quotidiens et non un emprunt partiel qu’accompagne un travail personnel d’écriture. Dans ce cas, la richesse de ces textes populaires comme ceux du « Baw Naan » serait sans doute rendue avec toute la poéticité du rythme et des traits d’esprit et l’on rejoindrait par là le baroquisme des surréalistes signant l’alphabet ( Id., « Suicide », in Le mouvement perpétuel, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1970, p. 83.) ou une page de l’annuaire du téléphone (André Breton, « PSTT », in Clair de terre, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1966, p. 49-50.) comme un poème mais, ici, sans l’extravagance ésotérique. Le baroquisme serait alors dans le refus de l’écriture et dans la préférence pour la transcription.
Néanmoins, le code-switching joue aussi le rôle d’une actualisation excessive qui, inscrivant le poème dans une signifiance culturelle localisée, refuse la poétique comme faite d’universaux du langage. Ainsi, au lieu des métaphores où comparant et comparé, le plus possible éloignés, nous placent dans la poéticité de l’obscur et de l’indécidable, du refus de l’actualisation, ici, même les structures syntaxiques rappellent les langues nationales, si ce ne sont les modes de signifiance et de construction du sens :
Tu renaîtras Cissé
Fatou Ndiaye Sow, « Destin de femme », in op. cit., p. 11.
Car Beela te chantera, le soir à Sabakh.
Au son des creuses
Beela chantera les spasmes
De tes nuits où palpite
La fureur sauvage de l’inconnu
…………………………
Et tes pas rythmeront le « ndaga »
Au son des « Leket » creuses
Ta danse glorifiera les promesses charnelles
Scellées d’extases sereines…
17Il faut malgré tout constater qu’aucune œuvre d’art ne saurait réaliser, complètement, l’ambition de reprendre des schèmes culturels et de se confondre avec eux. Le conformisme baroque des poétesses du Sénégal n’est donc qu’un aspect de leur poétique. Elles n’en veulent pas moins produire du haut langage et s’élever, tout en l’écrivant, au-dessus du quotidien pour réécrire le poétique. D’abord celui des poètes français, comme Baudelaire dont le poème « Élévation » (Les fleurs du mal) est réécrit dans le second recueil de Kiné K. Fall avec un sens orienté vers la religion ; ce qui est une forme de subversion et de détournement sémantique :
Ô pensée
Envole-toi loin
Sillonne l’immensité profonde
Va te purifier dans l’air supérieur
De l’espace limpide de la divinité
Derrière les chagrins les ennuis
Kiné Kirama Fall, « Il faut comprendre », in op. cit., p. 58.
Et les poids brumeux de l’existence
Heureux celui dont l’esprit s’élance
Vers les cieux
18Ensuite, vis-à-vis de la tradition littéraire africaine, malgré la volonté de s’enraciner dans la réalité sociale, il y a un réel désir d’éviter le plagiat. On comprend donc aisément, ici, pourquoi le tam-tam et le « xalam » sont évoqués et non imités, à travers le rythme, au contraire de la plupart des poèmes de Senghor, et pourquoi le chant est préféré à la danse quand bien même les sujets poétiques ont de cet art une expérience des plus riches :
Filles du pays des Torobé
Fatou Ndiaye Sow, « Fille du désert (ou le chant du Sahel) », in op. cit., p. 7.
Écoutons le Xalam chanter Ely Banna
Chant diapré d’éclats de crépuscule
Chant chaleur d’harmattan
Berce les soupirs obsédant nos sortilèges
Sur les rives sable de Guédé la Majestueuse
Tournant la dernière page de chacun de ces recueils, le lecteur reste indécis et son penchant taxinomique, insatisfait. Il se demande si la familiarité et la vulgarité presque prosaïque de ces textes ne relèvent pas de ce handicap fréquent chez les débutants et consistant à les maintenir quand ils écrivent, dans leur expérience la plus immédiate. Ou si l’écriture de la quotidienneté ne procède pas d’un choix moderniste délibéré, dans le sujet comme dans la forme. Chez la plupart, ce handicap semble cultivé comme des fleurs du mal et il devient évident qu’en plus du féminisme, ces poèmes retournent la poésie africaine dans ses thèmes, dans son regard sur la femme et dans la façon de construire le poétique. C’est là le paradoxe d’une quête de la différence au moment même où les poèmes militent pour une égalité sexuelle et, tout en dénonçant les stéréotypes sociaux défavorables, ne s’en sert pas moins de ceux qui vont dans le sens des idéologies élues.
La poéticité n’est certes pas dans les idées ni dans les pratiques scripturaires usagées et faciles comme la répétition en forme d’épizeuxes, même si ces pratiques sont décalquées d’un discours local. Mais la subversion de la tradition est, depuis Baudelaire et les romantiques, une forme de baroquisme qui porte une littéralité nouvelle, celle du refus de la litté ra lité. Il s’agit dans ce cas d’un choix lourd et considérable qui dépasse le simple fait de parsemer, par-ci, par-là, à la façon de Pierre Loti des expressions de couleur locale et exotiques dans des textes rédigés en français.