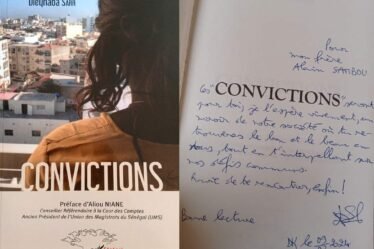Auteur du recueil: Fara NDIAYE
Titre du recueil: Mélopées Divines
Maison d’édition: L’Harmattan
Date de publication: Août 2020
Ecrire un ouvrage c’est laisser un héritage à la postérité. C’est laisser au monde une fenêtre à travers laquelle il vous découvre, vous voit, et même vous juge.
C’est pourquoi il est important de peser et penser chaque mot car une fois qu’il sort, c’est comme une marchandise au marché. Chacun peut se l’approprier et en faire ce qu’il veut.
Fara Ndiaye m’a permis enfin de poser des mots sur un mal que je trainais. Dès son avant-propos, il se confie sur le travail titanesque, aussi bien sur soi que sur le texte, à abattre pour donner vie à une œuvre. Écrire n’est pas un jeu. Publier n’est pas une course. Malheureusement la liberté qui est un charme pour l’art fait en même temps sa faiblesse. Par conséquent, aujourd’hui, il est difficile de voir les gardiens du Temple (est-ce qu’on en a même ?) faire un lever de boucliers contre ceux qui, pensant innover, font autre chose que de la poésie. « Lire, relire, éduquer un texte » est le premier pas vers le respect de son art.
Afin, il osa le dire :
« Verbiage sur le toit de vos textes vers marasmes
Rimes avortées rythmes asphyxiées
J’appelle le silence à la barre pour vous condamner
Ayez pitié de la poésie dévêtue »
C’est sur ces vers de la page 69 que je voulais entamer ma note de lecture mais aussi en faire une interpellation aux jeunes auteurs en leur demandant de soigner chacun de leurs textes comme si c’était le dernier. Je me sens mal placé de le dire puisque je suis en train de me construire, alors j’invite les critiques et les devanciers à assumer leur rôle de garde-fou en garantissant la liberté, tout en sachant que ses frontières avec la dérive sont fines.
L’auteur de Mélopées divines nous offre un voyage spirituel, dans lequel le ticket d’entrée est assuré par la poéticité du verbe. C’est une poésie peaufinée, ciselée, taillée, mesurée, domptée avec temps, patience, apprentissage. On ressent dans le souffle de chaque vers, le cheminement qui a mené à la maîtrise du style, du vocabulaire poétique et de la profondeur.
Dès l’entame de ce texte, le mot « rescapé » interpelle. C’est dans les tuyaux de la spiritualité que le poète espère se faufiler pour s’échapper des mondanités qui nous éloignent de notre quintessence.
Des Souffles lyriques font les premiers pas de l’aventure. Fara entame son voyage et nous embarque dans ce pèlerinage au royaume d’enfance, telle la nostalgie de Senghor à son Joal natal, le poète tisse avec les détails ses souvenirs d’enfance sur les lieux qui l’ont porté avec une précision chirurgicale. On voit le décor de Ndar et de Ndoffane, même sans y avoir jamais posé les pieds. Mieux encore, on a envie d’y aller.
Toujours dans cette première partie, on sent que certains textes sont écrits pour être dits. Je perçois le slameur derrière le poète.
Écoutons-le déclamer !
« J’ai trouvé ma femme ! elle m’enflamme
Je la chante dans mon slam
Ma femme est la femme la plus belle de toutes les femmes
Sa beauté surplombe celle de Nefertiti
Moi, la nuit, je l’appelle néné-tuti »
Le poète aime d’un amour idéal. Il peint la femme, la sublime non comme un objet d’art, mais comme une œuvre divine à travers laquelle il témoigne, accepte, célèbre la dextérité de Dieu. Si tous les hommes étaient poètes, les femmes seraient des muses choyées dans une tour en or.
Son idéal se trouve toutefois heurté par des maux de cette terre qui ont pour nom « jalouise, mensonge , haine ». Face à ces vices qui font des ravages, le poète convoque le petit oiseau de l’espoir, pour s’évader. Loin d’ici vers un monde peint de sainteté :
« Petit oiseau, tu voles suspendant tes ailes en l’air
Tel un cerf-volant, tes yeux évasifs convient l’espoir
Sur la route des cieux quand tu bats tes ailes le soir
Tes plumes à l’aplomb de ton vol séduisent les mers »
Dans des textes comme « Petit oiseau » P36 et « Espérance »P37, la ponctuation se fait rare et on ne voit pas le point final. Est-ce le besoin de liberté de l’auteur ? L’auteur ne s’est-il pas tué pour mieux exister, pour ne pas avoir de limites visibles, mais demeurer dans l’indicible ?
Dans sa quête spirituelle qui le détache de la terre, le poète n’a guère perdu espoir en l’homme. Il croient encore à la bonté, à la sincérité, à la sympathie de certaines personnes.
Il y a des gens…Oui il y’en a encore.
La magie de la poésie, on la vit dans cette œuvre. C’est quand le poète est un faiseur de miracles et parle à la nuit et au jour, au soleil et aux cours d’eau. À travers ses vers, il transcende chaque chose pour lui donner vie et parole. A l’interstice des rimes, il vit et nous fait vivre une intimité avec la nature sur laquelle nous ne jetions que des regards.
Et là, une petite promenade vers le rêve me rappelle celui de Nerval qui en fait une seconde vie. Ce moment où par un engourdissement nébuleux, le moi sous une nouvelle forme continue l’œuvre de la vie. Rêvons couchés ! Rêvons debout !
Quoi de mieux alors d’arpenter juste ce boulevard pour rêver d’un autre monde.
Pour expirer le dernier soupir lyrique, Fara nous peint un monde de paradis, d’égalité, de solidarité, où « la fidélité est une drogue ». J’en fais une prière et disons Amen !
Le recueil commence véritablement dans la deuxième partie avec « Effluves divines », le moment où chaque vers colle au titre du recueil, mais où on voit le processus par lequel le poète se cherche et cherche Dieu à travers une quête dense, profonde et existentielle.
Il a plu. Le Poète ne se limite pas à humer le pétrichor et de s’en délecter, il tend son vase et veut du vin. Il est résolument déterminé à goûter au nectar dont s’abreuvent ceux qui s’effacent en Dieu pour ne vivre que Lui, qu’en Lui.
« J’ai tué mes vers profanes par le souffle spirituel
Tel un ivrogne, dis-je, Ô soufis ! servez-moi du vin
Âme assoiffée, cœur divorcé du monde temporel
Ma plume crie en extase, mon âme exalte le divin »
Dans ce cheminement vers le Divin, le poète a erré dans le « ventre de satan ». il y a vu de la débauche ornée, et du venin aromatisé dont s’extasient les égarés. Ne voulant gouter à ce festin d’âmes éclopées, il a pris sa sébile pour se faire « mendiant de Lumière ». En anachorète incompris, il erre, marche, sillonne dans son mystère pour se chercher lui-même, afin de mieux connaitre Dieu.
Ici le niveau de la quête, la tension de la recherche deviennent intéressants. Le poète-bédouin arrive à faire table rase de tout, il n’entend plus, il ne voit plus. Il n’existe que là où les égarés n’ont plus de pieds. Il est dans le Fleuve de la Cause Primitive. Pour nous autre, il n’est qu’un ivrogne avec des folies en vers, pour ceux qui ont trouvé la Lumière, il est « ÉLU ».
Dans le vent, dans le soleil, dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, par diverses incantations, au risque même de se trouver dans une catacombe, il a cherché le Secret de Celui qui a « Cent mille couleurs ».
Les effluves divines sont une danse d’ivresse sur le parvis d’une quête longue et difficile, physiquement éprouvante pour abreuver l’âme. Lorsque la dimension physique ne voit plus, le poète entame une anagogie qui l’éloigne des mirages humains pour le faire trinquer à sa soif ontologique.
Pour s’élever dans ces espaces célestes, le poète a eu bien sûr des ailes. Avec des battements forts sur lesquels on sent la flamme du Tabernacle des Lumière, la profondeur des Odes mystiques, l’ésotérisme du Livre des théophanies. D’Al-Ghazâlî à Rûmi le Mawlana en passant par Ibn Arabi, le poète a su boire à la bonne table avant de voyager.
Je fus ravi de voir comment Fara a fait de la poésie son arme pour son « jihad », son combat contre ses démons intérieurs, les dérives des sens et des viles passions.
Toujours avec cette poésie, il y a un endroit mystérieux en nous qu’on explore grâce au silence. Silence…
Enfin, l’ascension continue certes, mais avec des accents de reconnaissances. La reconnaissance envers ses Maîtres, et envers DIEU.
Par l’élégance de Mawahibou, la clémence de Djeuzbou le poète rend hommage et montre sa gratitude au Prophète Mouhamed et à ses Guides spirituels qui lui ont montré la voix du soufisme. La plume ayant bu assez de lumière, brille suffisamment pour nous montrer clairement les palpitations du cœur du poète.
Cette gratitude est allée aussi à ces Hommes de DIEU qui ont souffert sur terre car ceux qui ne peuvent voir au-delà du voile, les ont considérés pour des hérésiarques, des blasphémateurs.
Il arrive un instant où le poète semble être arrivé dans sa quête, il n’existe plus vraiment et rend hommage à Celui qui est Tout, Qui est Partout. Celui qui parle dans l’orchestre de la pluie, dans le klaxon des voitures, dans le roucoulement des oiseaux.
Prêt, le poète embrasse lucide sa mort et écrit :
« Quand je ne serai plus de ce monde
Je continuerai ma vie dans un autre monde
Un monde où chacun contemple la Face du Seigneur
Ce monde est celui des Elus, celui des Reconnaissants »
En vérité, après un tel cheminement, la mort est une délivrance pour celui qui ne voit que DIEU. C’est pourquoi, après être mort pour mieux vivre, il pense aux morts qu’il rejoindra lui-même.
Au-delà de la reconnaissance, le poète rend grâce à Allah pour ce qu’il est : un être humain qui peut profiter du vent, du feu, de l’eau, des mystères de la nature. Ingrat pécheur est l’Homme malgré toute cette grâce, la plume ploie le genou pour demander pardon. En goutant à la lumière, il s’est rendu compte de sa finitude, de son imperfection et de sa fragilité. Lui, un être humain!
Le recueil « Mélopées divines » est une véritable ascension spirituelle où le poète s’est engagée à trouver la voix de la vérité.
Je suis un mauvais lecteur de poésie parce que je bois et je vis les vers. Si ce texte ne respire pas une logique mathématique, sachez que je transmets ce que j’ai vécu. Ivre de mélopées, je marche à présent vers le Divin.
Patherson